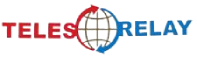Amin Maalouf : « Nous sommes au début d’une nouvelle guerre froide » , Jeune Afrique

Amin Maalouf : « Nous sommes au début d’une nouvelle guerre froide »
S’il est une muse que chérit particulièrement l’écrivain Amin Maalouf, c’est bien Clio, l’inspiratrice de l’histoire. Donnant à ses romans le décor des empires anciens, sassanide, abbasside, ottoman, il raconte dans ses essais les drames des âges modernes. Après avoir décrit Les Dérèglements du monde (2009) et peint Le Naufrage des civilisations (2019), ce guide au verbe ciselé nous entraîne aujourd’hui dans Le Labyrinthe des égarés, sa dernière œuvre, parue en octobre 2023. On y lit une vision décentrée de l’histoire contemporaine du monde, depuis Tokyo, Moscou et Pékin, mais concentrée sur les défis lancés par ces puissances passées ou à venir à l’Occident américain, sujet du dernier chapitre. « Ma conviction, en la matière, c’est que ni les Occidentaux ni leurs nombreux adversaires ne sont aujourd’hui capables de conduire l’humanité hors du labyrinthe où elle s’est fourvoyée », explique-t-il dès le prologue.
Élu le 28 septembre 2023 secrétaire perpétuel de l’Académie française, où il avait été accueilli en immortel en 2011, le Franco-Libanais a vécu avant cette apothéose les impasses, les volte-face et les emballements de l’histoire. Né à Beyrouth en 1949, trois ans après le départ des troupes françaises et en pleine nakba palestinienne (la « catastrophe » de l’exode forcé), il passe une partie de son enfance dans l’Égypte de Nasser avant de revenir au Liban, où il forge sa plume de journaliste en couvrant la politique internationale pour le quotidien An Nahar. Marié et père quand la guerre civile éclate en 1975, il s’installe alors en France, recruté par Béchir Ben Yahmed comme rédacteur en chef au service économique de Jeune Afrique. Comme il se plaît à le rappeler, c’est Renaud de Rochebrune, son ami et collègue d’alors, qui l’incite à publier sa première œuvre en 1983, Les Croisades vues par les Arabes. Il se consacre dès lors entièrement à l’écriture et obtient le prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanios.
Dans son dernier roman, Nos frères inattendus (2020), Maalouf s’aventurait dans le domaine dystopique, sur une Terre qui se précipite dans l’abîme nucléaire mais qui est sauvée presque miraculeusement de l’apocalypse. Par bien des aspects, son dernier essai constate que l’humanité se rue vers l’abîme sans ralentir, sans toutefois pouvoir compter sur un miracle. « Je ne prédis pas l’apocalypse mais il faut rester vigilants », tente-t-il de nous rassurer.
Jeune Afrique : De quels points de vue vous êtes-vous placé pour peindre cette grande fresque géopolitique qu’est Le Labyrinthe des égarés ?
Amin Maalouf : Essayer de voir les événements du monde depuis plusieurs points de vue est un élément important de ma démarche intellectuelle. On a naturellement tendance à regarder les choses depuis l’endroit où l’on vit, et c’est un effort de se demander comment on réfléchirait à Calcutta, à Lima ou à Abuja. Je suis né au Liban, j’y ai vécu pendant vingt-sept ans avant de m’installer en France il y a quarante-six ans et, si je vois les chose à partir de l’Europe, j’ai naturellement ce souci de m’interroger sur la manière dont les uns et les autres peuvent voir les événements du monde. Mon premier livre, Les Croisades vues par les Arabes, correspondait déjà à cette démarche et j’ai, dans ce nouvel essai, tenté de montrer une autre manière de considérer les défis posés à l’Occident contemporain. Pour cela, je me suis immergé dans l’histoire du Japon, de la Russie, de la Chine et des États-Unis, j’ai voulu m’imprégner de la culture de ces pays pour les raconter de l’intérieur et comprendre la vision du monde et les réactions, parfois les dérapages, de leurs dirigeants.
Vous débutez sur le constat que nous traversons « une des périodes les plus périlleuses de notre histoire » et concluez par la prédiction d’une « finale » dévastatrice entre la Chine et les États-Unis. On vous sent très pessimiste…
Je suis en effet inquiet de la marche du monde et je trouve qu’il y a beaucoup de périls auxquels nous ne faisons pas face : le péril nucléaire que l’on prend à la légère, les périls liés au climat, aux dérives des nouvelles technologies, des périls de toutes sortes contre lesquels notre monde a besoin de solidarité. Or, ce qui domine entre les dirigeants des grandes puissances, c’est au contraire la méfiance mutuelle et l’égoïsme sacré des nations. Une sorte de logique s’est installée qui consiste à boycotter son ennemi ou celui dont le jugement est vu comme inacceptable. C’est relativement récent dans notre histoire et ce n’était certainement pas l’attitude de feu Henry Kissinger, qui avait ses idées et sa stratégie pour son pays, mais qui n’aurait jamais dit « Mao est un ennemi, je n’irai pas le voir ».
Il faut critiquer ce que l’on pense devoir critiquer, combattre les idées qui le méritent, mais arrêter de dire que l’on ne parlera pas avec les Chinois, ou avec les Russes, ou avec les Américains. Il faut maintenir des relations, même avec ses ennemis, pour les défis qui exigent une solidarité planétaire comme pour la résolution des conflits locaux. Voyez le Proche-Orient, l’Ukraine, la guerre civile au Soudan, et tant d’autres crises qui se poursuivent sans fin, comme si l’on ne savait plus arrêter un conflit. Pis, comme si cela n’intéressait plus personne de les faire cesser.
la suite après cette publicité
À quoi attribuez-vous le regain des nationalismes, des identitaires, des communautarismes et autres séparatismes ?
Le passage, à l’issue de la guerre froide, d’un monde aux clivages idéologiques à un monde aux clivages identitaires est pour moi un élément clé. Les idéologies avaient structuré la vie politique comme la vie intellectuelle du monde depuis la fin du XIXe siècle et leur faillite – au premier rang celle du marxisme – a laissé un vide. Or, les gens ont besoin de s’identifier et de se situer dans leur société. Dès lors, le plus simple a été de se définir par sa nation, par sa religion, par des éléments identitaires forts que Samuel Huntington appelait civilisations.
Vous suivez donc Huntington dans son idée d’un retour du choc des civilisations ?
Le diagnostic qu’il fait quand il étudie l’évolution des mentalités est juste, mais je ne suis pas d’accord quand il y voit le retour de l’humanité à ses attitudes essentielles. C’est une nouvelle attitude car l’histoire n’a pas été une suite de conflits entre les civilisations. Les guerres napoléoniennes, les deux guerres mondiales se sont faites entre puissances européennes ; les Ottomans ont principalement combattu les Mamelouks du Caire puis la Perse safavide, autres puissances musulmanes ; etc. Notre époque est très spécifique et nous devons regarder comme un nouvel objet ces nouvelles rivalités.
Vous annoncez une confrontation américano-chinoise cataclysmique…
Probablement n’aura-t-elle pas lieu, mais je dis qu’il ne faut pas prendre à la légère un tel risque car, si nous avons eu la chance de connaître une fin non violente à un conflit Est-Ouest qui aurait pu entraîner la perte de la Terre entière, il ne faut pas en tirer la mauvaise conclusion que l’on finit toujours par s’arranger jusqu’au dernier moment. La situation peut déraper, des choses peuvent arriver que l’on ne peut plus arrêter. Je ne prédis pas l’apocalypse, mais je pense que nous assistons aux commencements d’une nouvelle guerre froide entre l’Occident coalisé autour de l’Otan et un certain nombre de puissances qui lui sont hostiles.

Le président chinois Xi Jinping à San Francisco, en 2023. © Carlos Barria/Pool via REUTERS
Ceux qui se gardent aujourd’hui de s’aligner derrière les uns ou les autres, que l’on appelle le Sud global, n’ont pas plus envie de voir émerger une autre puissance hégémonique, chinoise ou russe, que de voir se perpétuer l’hégémonie américaine. Les grands pays de ce Sud, Inde, Brésil, Afrique du Sud, et l’Arabie saoudite qui s’affirme maintenant dans ce sens, veulent un monde où ils seraient au même niveau que les États-Unis, la Chine et la Russie, où ils auraient pleinement leur mot à dire et que personne ne vienne leur dicter les attitudes à avoir. Une exigence légitime, mais qui implique une nouvelle légalité internationale, une réorganisation des Nations unies.
Aujourd’hui le jihadisme reste une idéologie universaliste qui défie l’Occident et fait peser la menace au sein même de ses sociétés. Quel danger représente-t-il ?
Il y a des tensions liées à la montée des conflits en Palestine et au Proche-Orient qu’il faut prendre au sérieux mais, à mes yeux, pas de véritable menace existentielle pour les sociétés concernées. Les attentats sont des événements tristes, malheureux, mais ils restent des actes individuels, très ponctuels et je ne vois pas, jusqu’à ce jour, d’éléments qui divisent les sociétés.
Vous ne partagez pas l’idée d’une « libanisation » de la société française, où certains nous voient vivre aujourd’hui « face à face et non plus côte à côte » ?
Ce n’est pas mon impression, même s’il y a des tensions dans les sociétés occidentales entre gens qui voient différemment les événements du monde et une intervention de ces conflits dans la vie politique des pays, je ne vois pas non plus de « libanisation », comme vous dites, en vue.
On diagnostique, aux échelles locales comme internationale, une banalisation de la violence, physique et verbale, du mensonge, du relativisme…
Ce sont des choses que j’entends souvent et qui ne me convainquent pas davantage. Toute l’histoire est une histoire violente. L’Amérique précolombienne a été victime des conquistadors, mais auparavant la violence y régnait. Dès que vous vous penchez sur l’histoire d’une civilisation, vous découvrez qu’il y a toutes les brutalités, les horreurs partout. Les paléontologues ont découvert qu’à la préhistoire, la proportion de gens qui mouraient de mort violente était supérieure à tout ce que l’on a pu observer par la suite. Donc nous ne venons pas d’un paradis d’harmonie, et je pense au contraire que nous allons vers un monde un peu moins violent dans une perspective historique.
De même sur un soi-disant triomphe du mensonge : je pense que la dose de mensonge et d’infox qu’il y avait autrefois est à peu près équivalente à ce qu’il y a aujourd’hui, sauf que l’offre d’information est bien plus vaste. Je me souviens de ma lointaine jeunesse au Liban, où je lisais tous les journaux, et il y avait autant de mensonges, de fabrications, de travestissements de la vérité à l’époque dans les journaux imprimés qu’il peut y en avoir aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Notre époque n’a pas inventé le mensonge, elle le diffuse un peu plus, à la différence qu’il est dénoncé et disséqué, on en est conscient bien plus qu’on ne l’était autrefois.
Quant aux valeurs promues comme universelles de démocratie, d’égalité, de libertés individuelles, les contradictions de l’Occident lui-même ne tendent-elles pas à relativiser l’universalité de ces valeurs, accréditant par exemple l’idée que si la démocratie fonctionne en Occident, elle ne serait pas faite pour les Arabes, les Africains ou les Asiatiques ?
Tous les peuples ont besoin de vivre dans la dignité, de s’exprimer librement, et il n’y a pas de peuples pour lesquels la démocratie serait bonne et d’autres pour lesquels elle serait mauvaise. Ce que je reproche, dans mon livre, aux Américains est de ne pas avoir fait ce qu’il fallait pour étendre ailleurs leur modèle – qui fonctionne à peu près correctement. Je suis persuadé qu’il y avait en Afghanistan comme en Irak une aspiration réelle à la démocratie, à laquelle l’occupant n’a pas su répondre, choisissant la solution paresseuse de dire que ces pays étant habitués à autre chose, ils n’y seront jamais aptes. Pire encore pour les États-Unis, ils n’ont jamais rien fait pour répandre la démocratie en Amérique latine, qu’ils dominent depuis deux siècles. Pas plus que les colonisateurs européens n’ont cherché à bâtir des régimes démocratiques dans les pays colonisés. Je pense que la diffusion de ses valeurs n’a jamais été une priorité de l’Occident.
Comment intégrez-vous le monde arabe et ses soubresauts sans fin dans votre grande fresque géopolitique ?
Voilà une zone marquée par un conflit qui ne cesse de s’envenimer depuis des décennies et pour lequel on n’a pas trouvé de solution, qui génère ses propres crises et ses propres guerres tout en s’inscrivant dans les rivalités mondiales que j’ai décrites et dans le fil d’une histoire mouvementée. Le Proche-Orient est depuis des millénaires une région clé entre trois continents, qui a toujours été un terrain d’affrontement, très morcelée entre les puissances plus qu’une puissance elle-même. S’y ajoute depuis cent ans le phénomène nouveau d’Israël, pour lequel on n’a pas encore trouvé de solution équitable qui permette à tous les peuples de vivre souverains, dignes et en sécurité sur leur territoire. À divers moments, les uns ou les autres ont refusé des solutions qui auraient pu être appliquées et nous arrivons à ce point où plus personne n’est en mesure de proposer une solution satisfaisante, laissant la voie au déchaînement de violence.
Pourquoi la guerre de Gaza, très localisée entre deux peuples, sidère-t-elle à ce point le monde ?
Nous sommes sur la terre de naissance des trois grandes religions monothéistes, les communautés religieuses qui y cohabitent sont nombreuses et partout les gens se sentent concernés par le sort de leurs coreligionnaires, ce qui a un effet toxique dans le monde. Si nous avions au Proche-Orient un exemple de cohabitation harmonieuse entre les adeptes des trois religions monothéistes, ce serait un modèle merveilleux pour l’humanité. Mais voilà, nous avons l’inverse, quelque chose qui nous dit constamment : « Regardez, on ne peut pas vivre ensemble, voyez ce qui se passe au Proche-Orient. » Un contre-modèle extrêmement toxique pour toutes les sociétés humaines.
À propos de Gaza, on peut opposer un récit occidental qui est plus ou moins l’écho du discours israélien et le récit qui attire l’attention sur la condition terrible des Palestiniens, n’est-ce pas là l’illustration d’une opposition croissante entre l’opinion arabe et l’Occident ?
Comme les croisades avaient été vues, également, par les Arabes, il y a une vision occidentale qui s’oppose une vision issue du monde arabo-musulman sur pratiquement tous les événements. À 74 ans aujourd’hui, j’entends ces interprétations divergentes depuis que je suis né. Je sais exactement comment chacun va ressentir, interpréter, raconter un événement, et les gens ne jouent pas et ne font pas de communication : ils y croient profondément. Hormis une petite minorité qui scrute le monde et analyse l’événement d’un point de vue professionnel en consultant toutes les sources disponibles, je peux vous assurer que 99 % des gens regardent les médias qui leur donnent la version qui les conforte dans leurs convictions. Chacun regarde la version de son choix et ignore les autres, et réciproquement : la multiplicité des médias n’a hélas pas créé une diversité de points de vue.
L’Occident tenait une occasion d’accompagner le monde arabe vers la démocratie après les révolutions de 2011, mais le résultat est à l’opposé : que s’est-il passé ?
Il y avait une possibilité effectivement, qui n’a pas été saisie. Une explication de cet échec est que les seuls mouvements organisés pour faire face aux régimes en place étaient les mouvements islamistes qui, s’ils savaient s’exprimer et s’épanouir dans l’opposition, n’étaient pas spontanément des bâtisseurs de démocratie, n’avaient pas de solutions pour la société et n’avaient même pas une véritable vocation à gouverner. Ainsi, les petits groupes de personnes qui avaient des aspirations démocratiques n’avaient pas de soutien populaire, les foules qui voulaient la chute des régimes en place étaient nourries par une idéologie inapte à produire un véritable régime moderne et démocratique.
Et le déchaînement féroce de certains régimes a démoli ces mouvements, notamment les plus authentiquement démocratiques. On a parlé des Printemps arabes en référence aux Printemps des peuples qui avaient soulevé tous les pays d’Europe en 1848, il faut maintenant se rappeler que ces soulèvements n’avaient débouché sur rien d’autre que sur des désillusions. Pour le monde arabe, c’est plus grave encore car la situation aujourd’hui y est pire que ce qu’elle était en 2011.
Mais cela n’a pas dissuadé le Maroc, l’Algérie, le Soudan, le Liban, l’Irak de se soulever cinq ans après et, sous les couvercles, les insatisfactions ne font que croître. Comment voyez-vous l’avenir des pays arabes ?
J’ai des espérances, mais pour le moment la situation est sombre dans ce monde arabe qui passe par une crise très profonde et n’est pas sur le point d’en sortir. Verra-t-on soudain un sursaut ? Je ne vais pas faire de pronostics. Je dois avouer que je ne prévoyais pas du tout les Printemps arabes et je regardais fasciné et surpris mon écran rapporter la situation en Tunisie puis en Égypte et ailleurs, avec beaucoup d’espoir, avant de comprendre peu à peu que cela s’effondrait partout. Avec le recul, c’est un désastre évident, non parce qu’il ne fallait pas se soulever, mais parce qu’il n’y a justement plus dans le monde d’idéologie capable de soutenir un mouvement pareil.
Il y avait les idées révolutionnaires issues du marxisme, qui ont fait faillite. Le nationalisme mène à toutes sortes d’autres attitudes qui ne sont pas la solution. L’idéologie fondée sur la religion n’en apporte pas non plus. Elle est unificatrice en apparence mais en réalité très divisive, on l’a vu, chaque fois que les Printemps arabes se sont approchés d’un pays aux communautés multiples, ça a éclaté. Les slogans pour la démocratie, c’est merveilleux, mais sans une classe sociale solide derrière pour bâtir un régime sur ces idéaux, ça fait pschitt.
Au-delà des vicissitudes historiques du Levant, quelles sont pour vous les sources de ce malheur arabe ?
Cette civilisation qui a été florissante, qui a été glorieuse, qui s’est développée dans les domaines de la philosophie, de la médecine, des sciences, des lettres depuis un certain nombre de siècles piétine, régresse. Quand l’Occident a débuté son expansion, au XVe siècle, pour triompher jusqu’à aujourd’hui, ce monde débutait son propre déclin. Dépassé, essoufflé, morcelé, il n’avait aucune chance de s’adapter et de s’unir pour offrir une solution de rechange. Car la réponse au défi occidental est très difficile, la Chine commence à peine à y parvenir mais après un demi-millénaire de défaites et de déchirements.
Un continent se situe un peu hors de votre histoire : l’Afrique. Beaucoup disent qu’elle est le continent de demain, comment la regardez-vous ?
L’Afrique est un continent avec un avenir, mais on ne pourrait dire lequel, même si l’on sait que dans les décennies à venir, une part significative de la population mondiale sera en Afrique et qu’avec le développement des nouvelles technologies, il devient possible de développer ses économies plus vite qu’on ne pouvait autrefois le penser. C’est quelque chose qui, à mon avis, va rester un mystère pendant les trente à quarante prochaines années et l’on découvrira probablement des réalités qui, aujourd’hui, nous sont invisibles.
La France s’y voit boutée hors de son pré carré, est-ce l’enterrement logique des reliques coloniales ?
Il y a des pays qui peuvent convoiter la place de la France sur le plan stratégique et économique, mais je pense que la place culturelle de la France en Afrique se maintiendra. Du point de vue de la langue française, c’est le premier continent et j’ai bon espoir qu’au niveau culturel et plus spécifiquement linguistique, les liens entre la France et l’Afrique resteront forts, et même iront en se renforçant.
Secrétaire perpétuel de l’Académie française, vous incarnez la conservation de la langue française, est-ce conciliable avec la créativité langagière partout à l’œuvre en francophonie ?
Détrompez-vous, nous avons de plus en plus de mots qui entrent dans le dictionnaire et viennent de néologismes nés en Afrique, au Québec ou au Liban ! Aujourd’hui notre dictionnaire, accessible en ligne, renvoie très souvent à des mots utilisés dans ces pays. Nous autres académiciens avons vraiment aujourd’hui une ouverture sur toutes les communautés francophones qui existent partout dans le monde, et qui sont en Afrique plus importantes que partout ailleurs.

Le Labyrinthe des égarés, d’Amin Maalouf, Grasset, 448 pages, 23 euros
Cet article est apparu en premier sur https://www.jeuneafrique.com/1516155/culture/amin-maalouf-nous-sommes-au-debut-dune-nouvelle-guerre-froide/